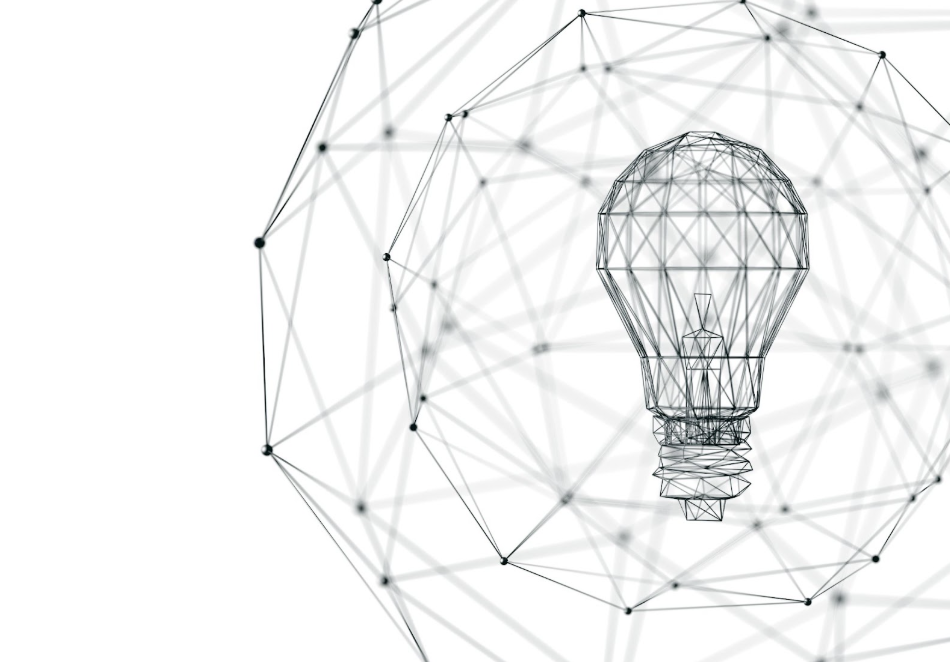À première vue, un Venture Studio peut sembler mystérieux. Ce n’est ni tout à fait un incubateur, ni un accélérateur, ni un fonds d’investissement classique. Pourtant, il combine un peu de chacun de ces rôles, tout en ajoutant quelque chose de plus fondamental : il construit ses propres startups de l’intérieur. Alors, comment fonctionne le modèle économique de ces structures qui attirent de plus en plus d’investisseurs et de fondateurs à travers le monde ?
Pour le comprendre, il faut revenir à l’essence même du Venture Studio : sa mission est de transformer des idées en entreprises viables, en assumant une partie des risques initiaux et en mutualisant les ressources nécessaires au lancement. Mais cette promesse doit reposer sur un modèle économique robuste.
L’investissement initial : le moteur du studio
Contrairement à un fonds de capital-risque traditionnel, qui attend qu’une startup existe avant d’y investir, un Venture Studio prend l’initiative. Il commence par financer la phase zéro : la recherche d’idées, la validation des problèmes de marché, la création des premiers prototypes.
Cet investissement initial provient généralement du studio lui-même, grâce à son propre fonds ou à des partenaires financiers. Par exemple, le Venture Studio parisien Hexa (anciennementeFounders) injecte environ 800 000 € dans chaque projet dès la phase initiale. Ce capital sert à recruter une équipe fondatrice, développer un MVP (produit minimum viable) et valider les premiers retours utilisateurs. En d’autres termes, le studio prend à sa charge une étape que la plupart des startups doivent assumer seules, souvent avec des moyens limités.
Le partage d’équité : un alignement d’intérêts
L’une des spécificités du modèle économique des Venture Studios est le partage d’équité. Puisque le studio assume le risque financier et opérationnel dès le départ, il reçoit une part importante du capital de la startup en échange.
Chez Hexa, par exemple, le studio conserve environ 30 % de l’équité lorsque la startup est « spin-offée », c’est-à-dire qu’elle prend son envol comme entité indépendante. Cette part peut varier selon les studios, certains allant de 20 % à 50 % selon la taille de l’investissement initial et le niveau de ressources mises à disposition.
Ce mécanisme aligne les intérêts : le studio, les fondateurs et les investisseurs ultérieurs ont tous intérêt à ce que l’entreprise grandisse et réussisse.
Des revenus différés mais potentiellement massifs
Le modèle économique d’un Venture Studio n’est pas conçu pour générer des revenus immédiats. Contrairement à une agence de conseil qui facture ses services ou à un incubateur qui demande des frais d’entrée, un studio mise sur le long terme.
Ses revenus viennent principalement de deux sources :
1. Les exits (revente d’actions lors d’acquisitions ou d’introductions en bourse).
2. La valorisation croissante de son portefeuille à mesure que ses startups lèvent des fonds et se développent.
C’est un pari patient, mais qui peut rapporter gros. L’exemple le plus emblématique reste celui de Flagship Pioneering, un Venture Builder basé à Boston, qui a contribué à la création de Moderna. Lorsque la biotech est entrée en bourse en 2018, la valorisation a explosé, générant un retour colossal pour Flagship.
Le coût de fonctionnement : une machine bien huilée
Bien sûr, maintenir un Venture Studio implique des coûts élevés. Ces structures emploient souvent des dizaines de personnes en interne: designers, développeurs, experts en marketing, recruteurs, juristes. Ce sont eux qui fournissent les services mutualisés aux startups en construction.
Ces coûts sont couverts par le fonds du studio, parfois complété par des financements externes. En mars 2025, Hexa a ainsi levé 29 millions d’euros via un financement bancaire structuré en crédit revolving, destiné à soutenir ses activités de création et à garantir une liquidité régulière. Ce type de financement illustre bien que les studios fonctionnent comme de véritables entreprises, avec une gestion de trésorerie et une stratégie financière sophistiquées.
Une logique de portefeuille
Un Venture Studio ne mise pas sur une seule idée, mais sur un portefeuille de startups. Chaque année, il peut en lancer plusieurs, avec l’idée que toutes ne réussiront pas. Mais si une ou deux deviennent des scale-ups internationales, elles compenseront largement les échecs éventuels.
C’est ici que le modèle économique prend tout son sens : il repose sur la diversification et sur un taux de réussite supérieur à la moyenne. Selon le Global Startup Studio Network, environ 84 % des startups issues de studios réussissent à lever un seed round, et 72 % atteignent la Série A, contre environ 42 % pour les startups traditionnelles. Ces chiffres montrent que le rendement d’un portefeuille issu d’un Venture Studio est statistiquement plus élevé et plus stable.
L’intérêt croissant des investisseurs
De plus en plus de fonds traditionnels et d’investisseurs institutionnels s’intéressent aux Venture Studios. Pour eux, le modèle présente un double avantage :
Une réduction du risque grâce à la validation précoce des projets.
Une meilleure rentabilité potentielle grâce à la part significative du capital détenue par le studio.
Un rapport de McKinsey souligne d’ailleurs que les startups issues de Venture Builders expérimentés génèrent en moyenne 12 fois plus de revenus au bout de cinq ans que celles lancées dans un cadre classique.
Vers une industrialisation de l’innovation
En observant le modèle économique des Venture Studios, on comprend qu’il ne s’agit pas seulement d’un mode de financement alternatif. C’est une véritable industrialisation de l’entrepreneuriat. Là où les startups classiques reposent sur l’intuition d’un fondateur isolé, le Venture Studio systématise la recherche d’idées, leur validation et leur exécution.
Cette rigueur explique pourquoi tant d’investisseurs voient dans les studios un modèle du futur : ils transforment un pari incertain en une stratégie d’innovation plus prévisible.
Le prochain chapitre
Le modèle économique d’un Venture Studio est donc un pari patient : investir tôt, assumer les coûts de construction, prendre une part du capital et attendre que les pépites émergent. Cela demande des moyens, de la discipline et une vision à long terme.
Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : les studios produisent des startups plus solides, plus rapides à croître, et avec un risque réduit pour les investisseurs. Dans le prochain cycle d’innovation, ce modèle ne sera plus périphérique : il deviendra une infrastructure centrale de la création d’entreprises.
En fin de compte, un Venture Studio, ce n’est pas seulement une usine à startups. C’est un moteur économique où chaque idée devient une opportunité, chaque risque une expérience, et chaque succès une preuve que l’innovation peut être à la fois créative et méthodique.